|
|
[ J'ai lu ] [ Cinéma d'Horreur ] [ Cinéma Fantastique ] [ Jeux Vidéos ] [ Series Fantastiques ] [ Vie Extraterrestre ] [ Insolite ] [ Esprits & Fantômes ]
|
|
|
|
Important pour les visiteurs du Blog
15/06/2007 23:13

Pour libérer une catégorie qui servira pour les series fantastique, je vais bientôt suprimer la catégorie " Les News" . Les news seront désormait accessible grace à un lien vers un article ou seront repertorier tout les messages qui pourront être consulter en cliquant sur les liens classer par date de publication. Je laisse cependant la catégorie "les news" encore quelques temps pour que les visiteurs s'y abitus Bonne nuit ^_-
| |
|
|
|
|
|
|
|
Quand deux vieux amis se retrouvent
15/06/2007 23:45

L'homme qui dut s'arrêter à sa grande fureur pour réparer un pneu à plat était quelqu'un d'instruit et ayant du bien. Ce qui ne l'empêcha pas d'avoir affaire à un zombi. Voici comment cela c'est passé. Un vieillard se tenant près de la voiture en panne dit au voyageur fort embarrassé qu'un de ses amis n'allait pas tarder à passer pour l'aider.
En attendant, il lui offrait de venir prendre un café dans sa maison. L'homme accepta et le suivit. Au cours de leur entretien devant un café, le vieillard affirma être un Bokor, un sorcier vaudou. Son invité témoigna d'un scepticisme poli.
Sur quoi le sorcier le considèra d'un air pensif et lui demanda s'il avait connu un certain M.Célestin, mort six mois plus tôt. Ils avaient été de grands amis, répliqua l'invité. " Aimeriez-vous le voir ? " murmura le bokor. Il fit claquer un fouet six fois de suite et une porte s'ouvrit. A pas traînants, l'air soumis, les yeux vides, Célestin entra - lui qui dans la vie avait été un homme du même milieu que le voyageur. Plein de pitié, celui-ci fit un geste instinctif pour tendre sa tasse au zombi. Le sorcier s'interposa précipitamment. Rien n'est plus dangereux, expliqua-t-il, que de donner quelque chose à un mort de la main à la main.
Le zombi attendait passivement. Le bokor expliqua que Célestin était mort, envoûté par un autre sorcier, et lui avait été vendu pour 12 dollars.
| |
|
|
|
|
|
|
|
Les fées de Cottingley

Croyez-vous aux fées ?
"Un événement historique : des fées photographiées ! " Tel était le titre d'un article publié en 1920 dans l'une des principales revues anglaises illustré avec la photo d'une fillette entourée par un groupe de petits personnages ressemblant à des fées. Un autre document montrait une seconde jeune fille contemplant une petite créature ailée semblable à un lutin. Les jeunes filles étaient France Griffiths et Elsie Wright. Elles s'étaient photographiées l'une l'autre et comme aucune des deux ne s'était jamais servi d'un appareil photo auparavant, il était peu propable que ce soit un habile truquage. L'auteur de l'article était Sir Arthur Conan Doyle (ci-dessous) , père de Sherlock Holmes, héros de célèbres histoires policières.

En quelques jours, le numéro avec les photos et l'article sur les fées de Cottingley était épuisé. La nouvelle de l'existence de ces documents fit le tour du monde et déclencha une controverse qui n'est pas éteinte aujourd'hui. Les filles semblaient sincères, les photographies aussi. Même de sceptiques enquêteurs se demandèrent si, après tout, il ne pourrait pas y avoir des fées.
Croyez-vous aux fées ? A cette question la plupart d'entre nous répondraient carrément : "Non ! " De tout les phénomènes surnaturels, les fées semblent le plus invraisemblable. L'idée est si absurde que nous usons même de l'espression "contes de fées" pour qualifier des mensonges évidents. Cependant, le créateur de Sherlock Holmes, ce maître logicien, se sentait assez sûr pour déclarer publiquement qu'il croyait aux fées. Et Conan Doyle n'était pas le seul. Lord Dowding (ci-dessous) , un des chefs de l'armée de l'air britannique pendant la Seconde Guerre mondiale et personnalité puissante s'il en fut, croyait implicitement aux fées. Il arrivait à cet homme raisonnable et plutôt sévère de montrer à ses visiteurs un livre de photos de fées et de parler d'elles avec autant de conviction que de tactique militaire. D'autres individus dignes de confiance et apparamment bien équilibrés, dont des ecclésiastiques, des professeurs et des médecins, ont soutenu que ces créatures existent - certains attestant en avoir vu. Mais ce qu'ils avaient aperçu était rarement de charmantes petites créatures avec des ailes en gaze légère, commes celles que France Griffiths et Elsie Wright avaient photographiées. C'était des êtres parfois hideux, souvent terrifiants et, à l'occasion, diaboliques.

La croyance aux fées était jadis universelle et elles étaient considérées comme une puissance redoutable avec laquelle il fallait compter. Evans Wentz, auteur de " La Croyance aux fées dans les contrées celtes " qui fait autorité en la matière, notait qu' "il semble n'y avoir jamais eu de tribu sauvage ou de race ou de nation d'hommes civilisés qui n'aient pas cru sous une forme ou une autre à un monde invisible, peuplé d'êtres invisibles." Wentz soutient que "les fées existent en réalité en tant qu'êtres ou intelligences invisibles". Considérant le monde des fées comme "un fait chimique", Wentz en venait à la conclusion que le royaume des fées est un endroit réel, existant "dans un monde invisible à l'intérieur duquel le monde visible est immergé comme une île dans un océan inexploré et qui est peuplé de plus d'espèces d'êtres vivants que notre monde, parce que imcomparablement plus vaste et présentant davantage de possibilités".
Voyons donc ce qu'il y avait sous ce titre de 1920 " Un évenement historique : des fées photographiées".
Aussi incroyable que l'histoire puisse paraître, on n'en a jamais démontré la fausseté.
Durant l'été de 1917, Frances Griffiths, jeune Sud-Africaine de 10 ans, arriva à Cottingley (ci-dessous) , petit village du Yorkshire, pour un séjour chez sa cousine Elsie Wright, âgée de 13 ans. Derrière la maison d'Elsie, il y avait un vallon solitaire, sauvage et ravissant, bordé par un torrent. Il ne tarda pas à devenir le lieu de prédilection des fillettes, qui prétendirent y rencontrer des fées et jouer avec elles. Rien d'étonnant si les parents d'Elsie ne prirent pas ces histoires au sérieux, mais à la longue, quand Elsie le supplia pour la énième fois de lui permettre de prouver qu'elle disait la vérité, Mr. Wright lui prêta son nouvel appareil de photo. Il glissa une plaque à l'intérieur, régla l'appareil et montra à Elsie comment s'en servir.

Moins d'une heure après, les fillettes étaient de retour, et, un peu plus tard, Arthur Wright développa la plaque. On y voyait sans erreur possible Frances Griffiths, le menton posé sur sa main et une troupe de fées avec des ailes de papillon folâtrant et dansant autour d'elle. (ci-dessous)

Stupéfait, mais pas encore convaincu, Mr. Wrigth prêta à nouveau aux fillettes l'appareil chargé d'une plaque. Cette fois, la photographie montrait Elsie avec une petite créature ailée en collant, maillot et bonnet pointu, prête à sauter sur elle. (ci-dessous)

Les parents Wright se dirent que les filles avaient dû se servir de découpures. Le père d'Elsie fouilla le vallon à la recherche de bouts de papier ou de rognures de carton, mais il ne trouva rien. On ne trouva non plus aucun indice dans la chambre à coucher des fillettes. Toujours persuadés d'êtres mystifiés, mais troublés de voir les filles se cramponner à leur histoire, les parents décidèrent que le mieux était de laisser tomber. Les fillettes ne purent plus se servir de l'appareil photo et les deux épreuves furent rangées sur une étagère ou elles restèrent pendant trois ans.
En 1920, Mrs. Wright assista sur place à une conférence. Le conférencier en vint à parler des fées et Mrs. Wright lui parla des photographies. En suite de quoi, celles-ci furent transmises à Edward L. Gardner, membre influent d'une organisation s'intérressant à l'occultisme, la société théosophique, qui se préoccupait particulièrement de photographie des esprits. Au début, Gardner ne fut guère impressionné, mais il fit quand même vérifier les négatifs par Henry Snelling, un photographe de profession expert en matière de truquages photographiques.
Snelling déclara que les deux photos étaient authentiques. "Ces deux négatifs sont ceux de photographies non truquées, intégralement authentiques à simple impression. Travail d'extérieur montrant le mouvement dans toutes les figures de fées. Aucune trace de travail en studio impliquant l'utilisation de silhouettes en papier ou en carton, de fonds sombres, de figurines peintes, ect. A mon avis, ce sont deux photos honnêtes, non retouchées."
C'est alors que Sir Arthur Conan Doyle apporta son immense réputation dans l'affaire. Il était en train de préparer un article sur les fées pour le numéro de Noël du Strand Magazine et pensa pouvoir utiliser ces photos pour l'illustrer. Mais il lui fallait d'abord des preuves supplémentaires de leur authenticité. Les négatifs furent examinés par Kodak. Ses experts déclarèrent aussi ne pouvoir trouver aucun indice de truquage, tout en n'en écartant pas la possibilité.
Gardner se rendit alors à Cottingley et s'entendit avec Elsie et Frances, laquelle vivait désormais en Angleterre, pour qu'elles essaient de prendre d'autres photos. Il donna aux jeunes filles, âgées maintenant de 16 et 13 ans, un nouvel appareil pour chacune avec un jeu de plaques, qui avaient été marquées sans qu'elles le sachent. Assez curieusement, aucun témoin indépendant n'alla avec elles dans le vallon, peut-être parce que les fées risquaient de se montrer seulement à des gens bien disposés à leur égard et avaient besoin de plusieurs mois pour s'habituer à des étrangers.
Bien que le temps ait été exceptionnellement mauvais tout au long des deux semaines suivantes, les jeunes filles prirent trois autres photos. (ci-dessous) Sur chacune figuraient des fées minuscules. La société ayant fourni les plaques vérifia que c'étaient bien celles marquées par ses soins et après une analyse approfondie ne put détecter aucune fraude. Gardner fut convaincu. Il souligna que les Wright ne recherchaient pas la publicité, qu'ils avaient insisté pour que leurs véritables noms ne soient pas révélés dans l'article de Conan Doyle et qu'ils refusaient tout paiement pour les photos. Il fit remarquer aussi qu'un truquage aurait demandé énormèment de temps et exigé des connaissances techniques dépassant de beaucoup celles d'un photographe amateur.

Se reposant sur le rapport de Gardner, Conan Doyle fit paraître son récit sensationnel. Il le fit suivre d'un autre article en mars 1921 et d'un livre intitulé " La venue des fées " . Mais il ne se rendit jamais en personne à Cottingley et ne parla jamais aux deux jeunes filles. Par contre, le voyant Geoffrey Hodson ne s'en priva pas . Après plusieurs semaines, lui aussi fut convaincu de leur sincérité. Gardner et lui conclurent que les deux jeunes filles étaient des voyantes et que Frances était un médium exceptionnellement bon dont l'ectoplasme était utilisé par les fées pour se matérialiser sous des formes sensibles à l'appareil photo.

Voyant les photos aujourd'hui, un sceptique n'hésiterait pas à dire qu'elles sont truquées. Les fées sont de petites créatures stéréotypées répondant à l'image classique jusqu'aux bouts de leurs ailes de gaze et dont les coiffures sont même à la mode de 1920. Sur la première et la plus célèbre des photos, Frances regarde droit devant elle sans se soucier apparemment des petits personnages folâtrant sous ses yeux. Dans la deuxième, la main d'Elsie ne semble pas normale - elle est d'une taille inhabituelle et paraît disloquée au poignet. Bien que les jeunes filles aient continué à voir les fées et prétendu que le vallon fourmillait de toutes sortes de fées, elles ne prirent jamais plus de photos.

Dans cette affaire, les adultes se sont-ils autosuggestionnés ? Les critiques font remarquer que Gardner était intervenu en tant que chercheur dans le domaine du paranormal, Hodson croyait fermement aux fées, Mrs. Wright était théosophe et, avec toute sa réputation de logicien, Conan Doyle était devenu un adepte du spiritisme, attiré vers cette croyance par suite du désespoir qu'il ressentit de la mort d'un fils tendrement aimé. Peut-être étaient-ils tous un peu trop portés à croire aux fées de Cottingley ?
Gardner s'en défendit avec chaleur, appelant l'attention sur un témoignage qui surgit tout à fait à l'improviste un an après l'article de Conan Doyle. Un amie de Frances Griffith, en Afrique du Sud, exhiba une copie de la première photo de fées que Frances lui avait envoyée dans une lettre de 1917. Non seulement cela s'était passé plusieurs années avant que Conan Doyle rende l'affaire publique, mais aussi Frances traitait la question des fées en une seule phrase désinvolte noyée dans un bavardage sur ses poupées, ses parents et une autre photo d'elle-même. Ce qui venait à l'appui de l'affirmation de Gardner que, pour Frances Griffith, il n'y avait rien d'extraordinaire à voir des fées et que, comme Elsie Wrigth le lui avait dit, Frances fixait l'appareil parce qu'elles s'intéressait davantage à la photo que l'on prenait d'elle qu'à des fées qu'elle pouvait voir tous les jours.
Gardner expliquait aussi la bizarre apparence de la main d'Elsie en disant qu'elle avait des mains et des doigts exceptionnellement longs. En ce qui concerne l'aspect trop conventionnel des fées, Geoffrey Hodson (ci-dessous)soutenait que les fées choisissent souvent de se matérialiser sous les formes sous lesquelles paysans ou enfants ont coutume de les imaginer ou en donnat d'elles une image qu'ils admirent particulièrement. " La surprise, disait-il, serait qu'elles soient différentes."

Selon Conan Doyle et Gardner, les jeunes filles ne cherchèrent pas à prendre d'autres photos après 1920 parce qu'elles avaient perdu leur simplicité et leur innocence enfantines. De plus, si elles continuaient à être de bonnes voyantes, quoique limitées, l'ectoplasme de Frances ne convenait plus au fées, aussi ne pouvaient-elles s'en servir pour prendre une forme susceptible d'être photographiée. " La puberté est souvent fatale au pouvoir psychique" , a écrit Conan Doyle. Ces photos ont été le résultat d'une combinaison exceptionnelle de circonstances et d'individus, a dit Gardner. Depuis lors, peu de tentatives pour photographier des fées ont abouti ; aucune n'a donné quelque chose de comparable aux résultats obtenus par Frances et Elsie.
Cottingley s'enorgueillit aujourd'hui d'un chemin portant le nom de " la combe aux fées ", souvenir d'un événement du XXé siècle et d'un phénomène apparemment inexplicable. Car, en dépit de l'accablante publicité à laquelle les Wright ne purent échapper malgré tout, personne n'a jamais démontré de façon convaincante que les photos des fées étaient truquées. Si elles l'étaient, alors la famille Wright - ou quelqu'un d'autre - possédait apparemment, en matière de photographie, un génie qui mystifia tous les spécialistes.
Et si les photos étaient authentiques ? Se pourrait-il, après tout, que les fées existassent ?

| |
|
|
|
|
|
|
|
Series Fantastiques
17/06/2007 00:14

Nous voici donc dans la catégorie Serie. J'avoue n'être pas un grand fan des serie fantastiques actuelles, j'ai suivi un petit peu " Les 4400 " mais j'ai fini par décrocher par manque d'intérêt. Excepter " Lost " qui reste pour moi la meilleure serie que j'ai pu suivre ma préférence est plutôt porter sur les series plus ancienne (et peut-être mal connu par la plupart d'entre vous) comme " Twin peaks " 1990,91 , " l'hôpital et ses fantômes" 1994, 97, " Les contes de la crypte " 1989,96, ou encore beaucoup plus vieux " La 4é dimension " dans les années 50,60. Sans oublié " Xfiles " et ses 9 saisons. Je commencerais par la serie danoise " l'hôpital et ses fantômes " .
L'hôpital et ses fantômes (Présentation + Tout les épisodes)
Twin Peaks (présentation + Tout les épisodes)
Les contes de la crypte (présentation + Tout les épisodes)
| |
|
|
|
|
|
|
|
L'hôpital et ses fantômes (présentation)
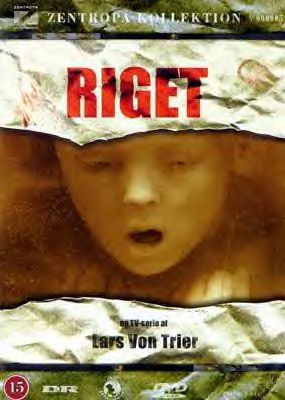
L'Hôpital et ses fantômes (Riget) est une minisérie danoise, créée par Lars von Trier en 1994 et diffusée sur le réseau DR1. En France, la minisérie a été diffusée sur Arte.
Ce feuilleton en 11 épisodes de Lars Von Trier, réalisateur danois de " Breaking the waves " et de la Palme d'or " Dancer in the dark ", est un mélange détonnant de " soap opera ", de satire médicale et de film d'horreur excentrique. Il a pour décor l'hôpital le plus important de Copenhague, nouveau temple de la technologie médicale, surnommé " the kingdom ", " le royaume ". Un hôpital construit sur d'anciens marécages, bientôt perturbé par nombre d'incidents étranges et inexpliqués.
Synopsis
L'histoire se déroule dans le département de neurochirurgie du Rigshospitalet (l'hôpital du royaume) de Copenhague, le principal hôpital de la ville. On suit un petit nombre de patients et membres de l'équipe médicale découvrant un monde surnaturel.
Fiche Technique
Titres : Riget et Riget II
Réalisation : Lars von Trier et Morten Arnfred
Scénario : Lars von Trier, Niels Vørsel (et Tómas Gislason : uniquement saison 1)
Musique : Joachim Holbek
Photographie : Eric Kress
Montage : Molly Marlene Stensgård et Jacob Thuesen
Opérateurs : Eric Kress et Henrik Harpelund
Costumes : Annelise Bailey
Production : Zentropa
Années de production : 1994 pour Riget et 1997 pour Riget II
Distribution
Ernst-Hugo Järegård : Stig Helmer
Kirsten Rolffes : Sigrid Drusse
Holger Juul Hansen : Moesgaard
Søren Pilmark : Krogshøj
Ghita Nørby : Rigmor
Baard Owe : Bondo
Birgitte Raaberg : Judith
Udo Kier : Åge Krüger / Petit frère
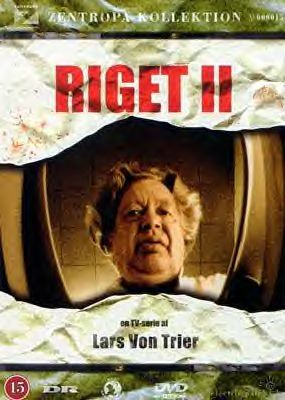
Critique de Romain Le Vern
Qu’est-ce que The Kingdom ? A l’origine, une série télé (titre danois : Riget ; titre français : L’hôpital et ses fantômes), transformée en (très) long-métrage, dans laquelle Lars Von Trier passe à la question plusieurs personnages soumis à d’étranges charivaris intérieurs dans un hôpital en pleine perdition. Impression d’être épié, sensation qu’une ombre menaçante plane sur les lieux ou qu’un fantôme hante les corridors. Toute l’artillerie de la série B horrifique passe à la moulinette cynique de Lars Von Trier qui parvient à exploiter deux genres sans se mêler les pinceaux : la comédie pure avec ses gimmicks et slapsticks et le fantastique avec ses ectoplasmes errants.

Lars Von Trier
Chaque saison est composée de quatre épisodes qui reposent grosso modo sur les mêmes bases avec une gradation propre au suspens et un finale tétanisant. Au gré des épisodes, on se rend compte que tous les épisodes reposent sur le même principe tels des jours sans fins amenés à se répéter (Helmer qui enlève ses enjoliveurs, réunion de boulot, coup de théâtre final, suspens graduel qui débouche sur une révélation) tout en restant intrigant et différent. C’est l’illustration du principe Deleuzien qui veut que les épisodes se répètent mais diffèrent à chaque fois. Sous l’impression de redite, Von Trier ménage des surprises. En cela le quatrième volet est ironique parce qu’il commence comme il ne devrait pas (Helmer donne les enjoliveurs de sa voiture aux enfants du coin et arbore un sourire faussement désinvolte). Dans la série, le Royaume est le lieu où l’hôpital fut édifié, comme l’explique le – sublime et ténébreux – générique. Les morts et les vivants cohabitent ensemble, les époques se chevauchent, le sang coule des murs. Mais, avant de verser les effluves gore, L’hôpital et ses fantômes est surtout une série poilante.

Helmer
Plus elle avance, plus elle déploie son humour acide et verse, notamment dans la seconde saison, dans un délire absurde de bon aloi. Car, en creux, au-delà de l’histoire de fantôme qui évoque une ghost story façon Richard Loncraine ou même Hideo Nakata (avec le recul, on pense beaucoup à Dark Water), Lars Von Trier décortique comme à son exquise habitude la cruauté des relations humaines avec une froideur drolatique, des personnages tordus et méchants, et fuit comme la peste toute idée de réalisme. Avec la notion de bluff (Epidemic, implacable "documenteur", en est la preuve), il s'agit d'un sujet récurrent dans sa filmographie, des Idiots (des "vous et moi" deviennent les idiots que la société voudrait qu’ils soient) à Dogville (ambiance dépouillée, pas de décors) ou même Dancer in the dark (pamphlet à mi-chemin entre le mélo et la parodie), grand film mal perçu parce qu’incompris sous prétexte de dramatisation outrancière. Le dessein de Von Trier n’est pas de faire pleurer dans les chaumières (le célèbre "terrorisme lacrymal") mais de faire rire de situations lourdement mélodramatiques (cf. la mère et l’enfant dans la seconde saison) et de jouer la carte de la subversion (sa plus mauvaise blague ayant été Manderlay et son coup de théâtre pas très finaud).

la mère et l’enfant
La seule fois où le cinéaste a réussi à signer une vraie œuvre bouleversante et touchée par la grâce avec le schéma LVT (où la protagoniste est soumise à la méchanceté des autres (encore une fois un Udo Kier redoutable)), c’est avec Breaking The Waves, vrai film sur l’amour fou qui démolit les espoirs et épuise les résistances.
En surface, la série s’intéresse aux relations entre les personnages dans le laborieux monde du travail et souligne au passage que personne n’est foncièrement un salaud même dans les cas les plus extrêmes. Au départ, ils sont tous ordonnés dans des principes précis ; à l’arrivée, ils perdent tous la boule. Même Helmer, le personnage le plus odieux de la série, gougnafier avec ses collègues (quitte à céder aux excès) et sa maîtresse (une femme soumise qui voit en lui l’apollon idoine), suscite l’hilarité, pour ne pas dire provoque la sympathique, tant son personnage s’avère outrancier et méchant. Dans le sillage des vrais méchants comme Von Trier aime à les peindre. Mieux ici, il réussit à rendre attachant voire charismatique un connard qui fait des soliloques où il s’adresse au spectateur en reluquant la cuvette des chiottes.

Madame Drusse
Parmi les protagonistes, il faut en mentionner quelques uns à l’instar de Madame Drusse, vieille maman castratrice, un peu fantasque, persuadée d’avoir le fluide et qui tente, comme dans la plus belle des ghost story, citons La maison du diable de Robert Wise, de communiquer avec les morts et de répondre à l’appel d’une enfant en détresse. Qui est-elle ? Que veut-elle ? Où se cachent les anges et les démons ?
Pilier de la série, incarnation du mal (il pousse le vice à aller jusqu’à Haïti pour se procurer un poison qui transforme ceux qui l’absorbent en mort-vivants), Helmer est un vieux médecin bourru cynique pas assez compétent pour être embauché dans son pays d’origine, qui ne cesse d’hurler sa haine du Danemark. Alors que finalement c’est sur lui qu’il crache. Helmer est tellement pingre qu’il met des cônes pour éviter qu’on lui pique sa place de parking et passe son temps à hurler sur les flics pour mieux balancer sa haine d’un pays qu’il abhorre. C’en devient un gag parce qu'il vaut mieux en rire. Pendant toute la première saison, la série traite de choses universelles (difficulté à travailler en équipe, relations conflictuelles avec des personnages qu’on n’affectionne pas, difficulté de se mettre en couple avec des horaires de taf pas possibles, incapacité de se lancer dans une relation ou de tomber amoureux).

En somme, impossibilité de s’abandonner soi-même à autrui. La série parle également d'un thème que Lars adore : l’abnégation. La naïveté de personnages confrontés à la cruauté âpre de leurs semblables. Ici, le milieu hospitalier, désaffecté et déshumanisé, qui s’occupe plus des guéguerres intérieures que de des patients.
Chaque plan de la série semble comme habité par une entité maléfique qui s’exprime dans les ombres ou à la périphérie du cadre. A chaque instant, le cinéaste traduit ses phobies. On savait LVT friand d’hypnose (Element du crime et Europa fonctionnent comme des séances d’hypnose, Epidemic s’achève sur une séance d’hypnose), il nous le confirme dans le second épisode de la première saison où un patient se fait opérer sous hypnose, précisément par l’hypnotiseur dans Epidemic qui sortait de prison après avoir purgé une peine pour le viol d'une quinzaine de femmes sous hypnose (film également référencé lors d’une scène où une étudiante regarde un film d’horreur et dans lequel on entend les cris de la fameuse séance d’hypnose d’Epidemic). De la même façon que Madame Drusse a recours à l’hypnose en faisant pénétrer son fils dans le passé du Royaume (hilarante scène où il se transforme en pingouin pour affronter un tigre).
Lars démontre une certaine habileté à distiller une atmosphère flippante par la grâce d’une mise en scène virtuose, de plans-séquences travaillés et de scènes potentiellement angoissantes. Mais n’oublie à aucun moment l’humour de situations où le dérisoire et l’horreur grincent de concert (le passage des archives dans l'épisode 3 de la saison 1). A chaque fin d’épisode, on a également droit à une intervention de Lars Von Trier, en speakerine (ci-dessous), qui s’adresse au spectateur : "alors, vous avez trouvé ça monotone et déprimant ?

Mais regardez votre vie, n'est-elle pas monotone et déprimante ? En cela, oui, on est toujours plus à l’aise dans la familiarité." Entre les histoires d’intermittences du cœur et les coups pas drôles (une tête de cadavre dans un sac), tous les personnages sont en proie à d’étranges tohu-bohus qui pourraient s’expliquer par le lieu qui est (peut-être) hanté. A la fin de la première saison, l’explosion est imminente (appels anonymes d’une mystérieuse ambulance, ville étrangement déserte et apocalyptique…) avec la naissance – mémorable – d’Udo Kier. Etrange, vraiment. Mais admirable et passionnant.

Udo Kier
L’hôpital a beau organiser des "opérations sourire", tout le monde tire la tronche. Le faux positivisme ambiant confine à la niaiserie mais c’est la bonne impression qu’il faut donner. On privilégie l’apparence au risque de laisser les conflits s'agiter entre eux. On camoufle les heurts comme on refuse d’admettre que l’hôpital est malade, hanté, déshumanisé. D’une manière plus générale, c’est une véritable autopsie de la férocité universelle, sur un ton cynique et drôle, et une confrontation du rationnel et de l’irrationnel, du mal et du bien, des cornes de diables vociférateurs et des ailes d’anges muets. La vétusté de l’hôpital est celle des relations humaines. Si deux personnages continuent à se détester, ils ne sont voués qu’à leurs pertes réciproques et finissent par s’effondrer. C’est la leçon – très morale – que Lars nous assène, à travers deux personnages mongoliens qui résument de manière explicite les leçons à tirer de chaque épisode. Et Lars rit. Son rire est plus grinçant qu’à l’accoutumée. Découvrir sa série, c’est redécouvrir son cinéma.
 
Tout les épisodes
Saison 1
Saison 2
| |
|
|
|
|
|
|
|
L'hôte indésirable (S1-01)

Krogschoy
Il y a quelque chose de pourri dans le meilleur hôpital du Danemark.
Il fait nuit. Le jeune neurologue Krogschoy voit soudain s'évanouir comme par enchantement une ambulance maculée de sang qu'il avait aperçue un instant auparavant...
Le professeur Helmer, grand spécialiste suédois du cerveau, déteste les Danois et les simulateurs. Comme cette Madame Drusse, qui prétend être atteinte de tous les maux possibles et imaginables.

Madame Drusse
Elle affirme, de surcroît, avoir entendu les cris de détresse d'une enfant dans la cage d'ascenseur, et elle organise des séances de spiritisme avec ses voisines de chambre. Tout cela va la conduire à Mary, une petite fille illégitime assassinée en...1919 par son père, le Docteur Krüger, au demeurant l'un des fondateurs du vénérable hôpital.
Le corps médical en place réfléchit aux moyens de faire cesser certaines rumeurs faisant état d'opérations chirurgicales ratées.

Mona
Comme celle pratiquée sur la jeune Mona, aujourd'hui handicapée, par le professeur Helmer. Les chefs de service de l'hôpital ont fondé une loge qui leur permet de mieux s'entraider, mais surtout de s'amuser ensemble comme de véritables potaches.
Pour améliorer le climat de travail de son service, le Professeur Moesgaard lance l'opération "Brise matinale"
| |
|
|
|
|
|
|
|
Que ton règne arrive (S1-02)

Rigmor
La mère de Mona se plaint du Professeur Helmer qui a rendu son enfant infirme.
Un haut fonctionnaire du ministère de la Santé demande à voir le rapport d‘anesthésie, qui a disparu. C‘est en fait Rigmor, anesthésiste du service et maîtresse du docteur Helmer, qui a détruit volontairement le rapport.
Un patient, allergique à l‘anesthésie classique, est opéré sous hypnose, ce qui rend Helmer furieux. Alors que le malade est inconscient, il voit une petite fille dans la pièce. Elle ressemble à s‘y méprendre à celle aperçue par Madame Drusse.
La vieille dame décide de jouer les détectives et force son fils, Bulder, à l‘assister dans son enquête. Ils recourent aux services d‘une autre malade, Madame Mogensen, qui est à l‘agonie, mais passionnée par le spiritisme. Entre la vie et la mort, elle va entrer en communication avec le petit fantôme.
De son côté, Bondo, un médecin spécialiste en pathologie, a mis à jour le cas de cancer du foie le plus passionnant de sa carrière.

Bondo
Ce même professeur donne également des cours de pathologie aux étudiants. Il met en garde le jeune Mogge : s‘il apprend que c‘est lui le responsable de la disparition de la tête du cadavre, il sera renvoyé. Pour se rapprocher de Camilla, Mogge devient cobaye pour le laboratoire du sommeil.
Une idylle se noue entre le jeune neurologue Krogschoy et un autre médecin, Judith.

Judith
Krogschoy s‘est aménagé un espace secret dans les sous-sols de l‘hôpital. Il y stocke tout ce qu‘il peut récupérer et recycler. Il parvient ainsi à avoir un certain ascendant sur la plupart des professeurs grâce à ses services rendus.
Mais Judith est enceinte d‘un homme avec qui elle a eu une liaison quelques mois auparavant. Krogschoy est très amoureux et accepte la situation.
| |
|
|
|
|
|
|
|
Ecoute et tu entendras (S1-03)

Helmer
Madame Krüger est une malade qui n‘a plus toute sa tête. Elle croit vivre en 1919 et parle d‘une chanson écrite à l‘époque à propos de la petite Mary : ?Dans un service de l‘hôpital, là où les lits sont blancs, toussait une jeune enfant“.
Le Professeur Helmer apprend qu‘il existe toujours un double des rapports d‘anesthésie aux archives. Il est atterré et cherche à savoir comment y accéder pour récupérer à tout prix le double du rapport de la petite Mona.
Sinon, il pense avoir trouvé une solution pour le Docteur Bondo. Puisque le fils et la femme du malade atteint du cancer du foie refusent de faire un don d‘organe à la science, il faudrait transplanter le foie du patient moribond sur une autre personne, sans en parler à la famille, évidemment. Mais qui serait candidat pour recevoir un foie rongé par la maladie ?
Helmer croit Madame Drusse sourde et l‘envoie chez l‘oto-rhino. La vieille dame persuade le spécialiste de filtrer et d‘amplifier le son de son local insonorisé. Tous deux finissent par entendre la plainte de Mary : ?Pourquoi veut-on me tuer?“

Mogge
Mogge constate que la tête a disparu de son casier. Il est contacté par un mystérieux maître chanteur qui n‘est autre que Krogschoy, en possession de la tête. En échange de son silence, Mogge doit coopérer avec lui et trouver un moyen de s‘introduire aux archives pour récupérer le double du rapport d‘anesthésie de Mona. Le même soir, Helmer, Mogge et Krogschoy se retrouvent aux archives...
De son côté, Madame Drusse fouine aussi du côté des archives à la recherche du dossier médical de la petite Mary.
| |
|
|
|
|
|
|
|
Un corps étranger (S1-04)

Mary
Le cadavre de Mary, morte à l‘âge de six ans, n‘a jamais été enterré. Son corps est resté à l‘hôpital où il est conservé dans le formol. On est frappé par la bouche grande ouverte et l‘aspect de terreur qui marque le visage.
Les médecins ont transplanté le foie malade du patient dans le corps du Docteur Bondo, seul moyen légal pour lui de continuer ses investigations sur l‘hépato-sarcome. L‘organe atteint sera ensuite prélevé et l‘on réimplantera à Bondo son propre foie. Mais un problème se pose lors de l‘opération et le chirurgien est obligé de conserver le foie malade. Tandis que ses collègues cherchent un nouveau foie aux quatre coins de la Scandinavie, le cancer menace de tuer Bondo.
Krogschoy a réussi à obtenir une copie du rapport d‘anesthésie sur l‘opération de Mona. Helmer ne peut plus lui échapper. Pour le coup, Helmer commence à s‘intéresser à ce que lui a raconté Rigmor, passionnée de Haïti, à propos des hommes devenus zombies grâce à un mystérieux poison. S‘il pouvait neutraliser Krogschoy... Helmer qui devait partir à Haïti en amoureux avec Rigmor, change d‘idée.

Rigmor & Helmer
Il décide d‘y aller avec un haïtien qui travaille à l‘hôpital.
A l‘extérieur de l‘hôpital les gens ont entendu parler de l‘opération ?Brise matinale“. Une rumeur court : le ministre de la Santé devrait faire une visite surprise des locaux de l‘hôpital.
Comme Madame Drusse, le Docteur Krogschoy est maintenant en contact avec les forces de l‘au delà. Un jour il croit voir sa bien-aimée, Judith, transparente et en conclut qu‘elle est peut-être un fantôme !
| |
|
|
|
|
|
|
|
Un mort-vivant (S1-05)

Madame Drusse
Madame Drusse a tout compris : Mary a été tuée par son père, le Docteur Aage Krüger. Cette petite fille était illégitime et Krüger souhaitait cacher son existence à sa famille.
La tumeur progresse à l‘intérieur du corps du Docteur Bondo. Et bien qu‘entre-temps on ait trouvé un organe sain, il préfère pour le moment garder le foie malade.
Rigmor apprend par Krogschoy que son amant est parti sans elle à Haïti. Elle manifeste un vif dépit, s‘empare d‘un revolver et se rend dans les sous-sols où elle se met à tirer à vue sur des souris blanches. Madame Drusse voudrait que le petit fantôme de Mary retrouve la paix.

Mary
Elle demande l‘aide de Krogschoy et pour le convaincre, lui raconte son histoire. Elle lui montre une photo de Aage Krüger à l‘époque du crime en 1919. Krogschoy réalise avec effroi que Krüger ressemble trait pour trait à l‘homme qui a abandonné Judith enceinte. Krogschoy convainc Judith d‘avorter. Le fils qu‘elle porte est le fils du fantôme d‘Aage Krüger. Trop tard. Les contractions de Judith commencent. L‘accouchement est douloureux et l‘enfant naît au monde monstrueux.

Avec Krogschoy et Bulder, Madame Drusse pratique un exorcisme dans le sous-sol de l‘hôpital pour sauver l‘âme de Mary. Elle perce un trou dans un mur et conjure à force de prières l‘esprit de la petite fille d‘y dormir en paix. Ce que ne sait pas Madame Drusse, c‘est que les fantômes se sont déjà échappés...
De son côté, Mogge constate que le frigo où Krogschoy détient la tête n‘est pas cadenassé. Il la prend et s‘en débarrasse dans le trou creusé par madame Drusse.
| |
|
|
|
|